 Sa vie, elle la raconte. La décortique. Et nous, lecteurs ( je devrais dire lectrices), en prenons des bouts. Tout nous parle dans la vie d’Annie Ernaux. Et pour cause. Elle parle de nous.
Sa vie, elle la raconte. La décortique. Et nous, lecteurs ( je devrais dire lectrices), en prenons des bouts. Tout nous parle dans la vie d’Annie Ernaux. Et pour cause. Elle parle de nous.
Depuis des décennies, cette septuagénaire aux cheveux auburn sait trouver les mots pour parler de l’enfant qui meurt, de l’amour qui s’éteint, de l’avortement, de la maladie d’un parent, de la jalousie qui s’installe ou du temps qui passe et fait son oeuvre… Elle nous tend un miroir. Se sert de ce matériau autobiographique pour raconter nos vies.
Avec « Mémoire de fille », elle pose la dernière pièce du puzzle de sa vie. La pièce manquante. La faille qui explique. Qui justifie. La » fille de 58 « se raconte. Enfin.
Annie Ernaux l’a souvent dit, écrit : ce sont les deux années passées entre ses dix-huit et ses vingt ans qui l’ont rendue écrivain. Une période explorée, exploitée désormais. Grâce à ses souvenirs, ses impressions. Ses carnets intimes, eux, ont été brûlés par sa mère depuis longtemps.
Au fil des pages, « la fille de 58″ se laisse donc approcher. Elle s’appelle Annie Duchesne. Nous sommes en 1958. Elle va avoir 18 ans pendant la colonie qu’elle a rejoint à Sées, dans l’Orne, comme monitrice.
La fille de l’épicier d’Yvetot, libre enfin, évolue dans un univers éloigné de son lycée tenu par les soeurs. Là, elle découvre autre chose. Elle est gauche, presque niaise.
Choisie puis rejetée par le beau H., le moniteur en chef, elle raconte, explique la meurtrissure de cette première expérience sexuelle ratée. La honte qui en suivra. Le mépris aussi dans lequel le reste de l’équipe va la laisser alors qu’elle se donne aux autres garçons comme pour laver l’affront du rejet initial.
Après la colonie, elle mettra deux ans à errer, à se perdre. Pas guérie. Son corps le lui dira. Cinq ans plus tard, elle rencontrera celui qui deviendra son mari.
Dans « Mémoire de fille », Annie Ernaux passe du « je » au « elle » pour évoquer la fille de 58. Une distanciation qui oblige à essayer de comprendre. Et de ne pas oublier. Cette fois encore, l’auteure du « moi » frappe au coeur du lecteur. Sa conscience de classe fait mouche. Son approche sociologique aussi d’ailleurs. Et son talent d’écrivain fait le reste. Absolument indispensable, comme l’ensemble de son oeuvre, d’ailleurs.
Extraits
Page 50 :« Je me passe et repasse la scène dont l’horreur ne s’est pas atténuée, celle d’avoir été aussi misérable, une chienne qui vient mendier des caresses et reçoit un coup de pied. Mais ce visionnement réitéré ne vient pas à bout de l’opacité d’un présent disparu depuis un demi-siècle, laisse intacte et incompréhensible cette aversion d’une autre fille à mon égard.
Ne reste que cette certitude : Annie D, la petite fille gâtée de ses parents, l’élève brillante est, à ce moment précis, un objet de mépris et de dérision dans le regard de Monique C. et de Claude L., de tous ceux qu’elle aurait voulu ses pairs. «
Pages 63-64 :« La fille de 58 ne s’offusque pas, il me semble même qu’elle s’en amuse, comme d’une agressivité moqueuse usuelle à son égard. Peut-être y voit-elle une preuve supplémentaire de la fausseté de leur jugement. Il y a erreur. Elle n’est pas ce qu’ils disent qu’elle est.
Cette certitude, à quoi l’attribuer aujourd’hui ? A sa virginité, qu’elle conserve avec détermination, à son brillant parcours scolaire, sa lecture de Sartre ? Plus que tout : à son amour fou pour H, l’Archange comme elle continue de l’appeler jusque devant Claudine D – qui, le doigt sur la tempe, la traite de complètement siphonnée – à cette espèce d’incorporation de lui en elle qui la tient au-dessus de la honte.
Ce n’est pas elle, la honte, j’en suis sûre, qui a fixé le souvenir des mots au dentifrice rouge, c’est la fausseté de l’insulte, de leur jugement à eux, de l’inadéquation entre putain et elle. Je ne vois rien dans cette période qui puisse s’appeler honte. «
Page 149 :« Il me semble aussi que j’avais voulu revenir à S et revoir la colonie parce que j’espérais ainsi puiser la force d’écrire le roman que je voulais entreprendre. Une sorte de préalable nécessaire, bénéfique à l’écriture, de geste propitiatoire – le premier d’une série qui me fera plus tard retourner dans divers endroits – ou de prière, comme si le lieu pouvait être un obscur intercesseur entre la réalité passée et l’écriture. Le détour par S s’apparentait, au fond, au baiser que, à la suite des pèlerins et au grand dégoût de M. qui s’en était gardée, j’ai déposée sur le pied de la Vierge noire de Montserrat en formulant le voeu d’écrire un roman. »
« Mémoire de fille », Annie Ernaux, Gallimard, 15€.
Marqueurs:"Mémoire de fille", amour, Annie Ernaux, cheminement, colonie de vacances, expérience sexuelle, fille de 58, honte, introspection, jeune fille, Orne, première fois, puzzle, quête, sexualité
 Catherine Cusset est de retour ! L’auteure française, installée à New-York depuis des années, est actuellement très en vue (dans les librairies et les short-lists des prix littéraires. Elle figurait dans les derniers romans en lice pour le prix Goncourt qui est finalement allé à Leïla Slimani pour « Chanson douce », à découvrir très prochainement sur le blog) grâce à son nouveau roman, « L’autre qu’on adorait », paru pour cette rentrée littéraire chez Gallimard.
Catherine Cusset est de retour ! L’auteure française, installée à New-York depuis des années, est actuellement très en vue (dans les librairies et les short-lists des prix littéraires. Elle figurait dans les derniers romans en lice pour le prix Goncourt qui est finalement allé à Leïla Slimani pour « Chanson douce », à découvrir très prochainement sur le blog) grâce à son nouveau roman, « L’autre qu’on adorait », paru pour cette rentrée littéraire chez Gallimard.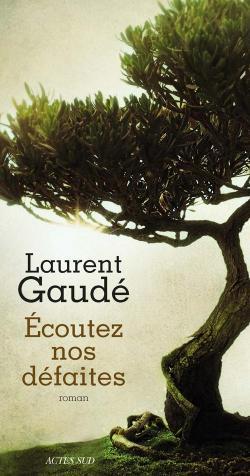
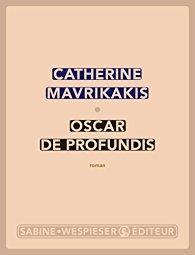

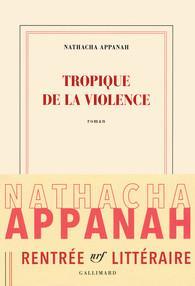

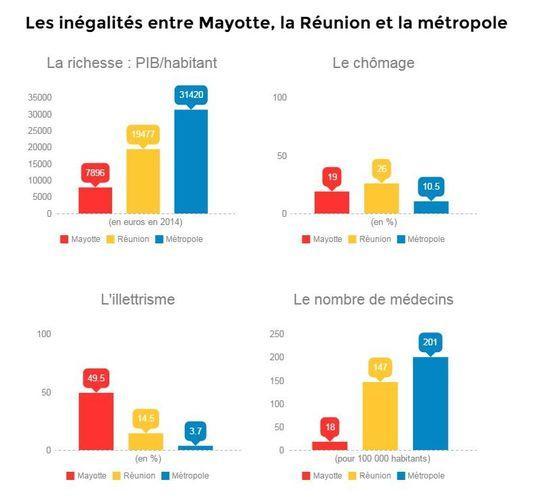



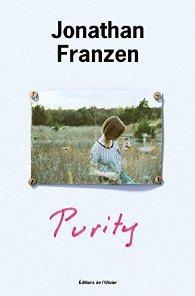

 Journaliste à Tours pour la Nouvelle République, je suis une avaleuse de livres, une gourmande de romans et autres objets écrits contemporains. (
Journaliste à Tours pour la Nouvelle République, je suis une avaleuse de livres, une gourmande de romans et autres objets écrits contemporains. (